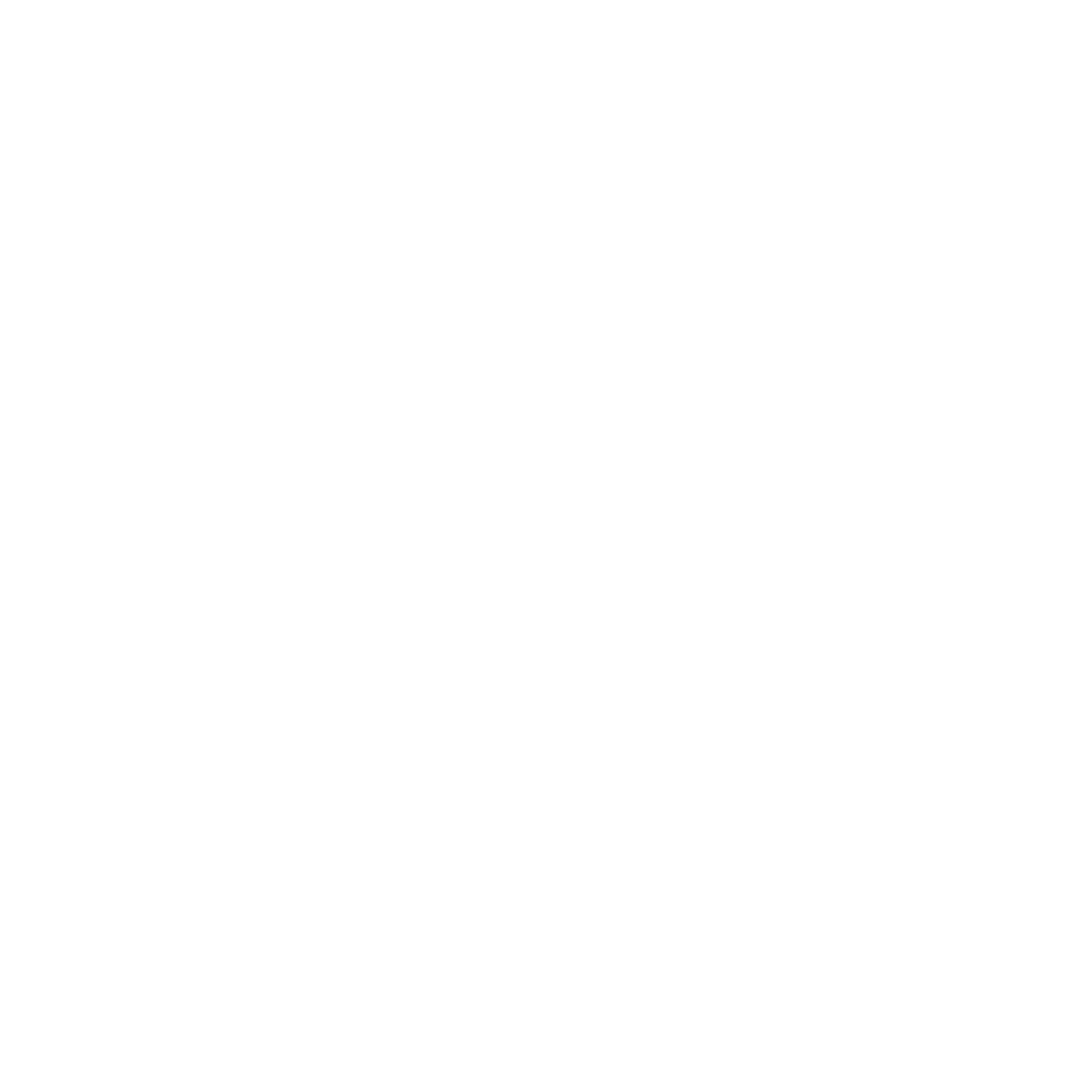Tourné pour Apple TV, F1 de Joseph Kosinski sort finalement sur les écrans de cinéma. Bien lui en prend : le film est un pur divertissement pensé pour l’expérience de la salle, enlevé et spectaculaire.
Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d’une écurie en faillite. Il le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre.
Des failles dans le moteur
À première vue, il n’y avait pas grande chose à espérer de ce F1. Film ouvertement sous licence, pensé comme le dernier étage d’une fusée marketing autour d’un renouvellement de public de la Formule 1, le tout ressemblait à une publicité même pas déguisée. Un énième coup d’une plateforme (Apple TV) visant à combler la case « blockbuster à 200 millions de dollars » sur sa grille de service vidéo.
Commençons alors par évacuer tout ce qui ne va pas : la musique de Hans Zimmer, sorte de medley insipide de tubes mainstream, et qui prouve que les grandes heures du maestro sont décidément bien derrière lui. Le scénario aussi, trois fois trop long, peuplé des stéréotypes du genre (le pilote surdoué, la jolie fille qui tombe dans les bras du héros, le rookie arrogant, l’homme d’affaires cupide) et dont le canevas ne risquera pas de brusquer les amateurs de film de sport.
Soit, ici, une ancienne vedette du pilotage, Sonny Hayes (Brad Pitt), retiré des circuits professionnels à la suite d’une très grave blessure, et qui se voit rappeler à la compétition par un ami de longue date (Javier Bardem, pas mal) pour l’aider à sauver son écurie de Formule 1, menacée de disparition. Il va devoir prendre sous sa coupe un jeune prodige très doué mais peu enclin à l’écouter. Pour qui aurait déjà vu ne serait-ce que Jours de Tonnerre, Le Mans avec Steve McQueen ou Ford v Ferrari, le déroulé de l’intrigue prendra de fastidieux airs de redite.
Inutile aussi d’espérer quelque double fond que ce soit du récit sur son univers automobile. Sans verser dans la glorification, F1 regarde son monde avec une froide neutralité. Sur l’univers de la course, ses entrailles et ses dérives, le spectateur ressortira de la salle probablement aussi ignorant qu’il n’en est rentré, voire davantage abruti tant le film cumule les facilités d’écriture (les fameuses safety car), malgré le souci constant d’ancrer son histoire dans le contexte le plus réaliste possible, vrais décors de GP à l’appui.

À fond la caisse
Qu’est-ce qui marche, alors ?
Tout ce qui se situe entre les lignes du script, c’est à dire les courses. Au fond, et c’est probablement la chose qui a intéressé Joseph Kosinski dans cette aventure. Le film vaut avant tout pour les trente ou quarante minutes qui s’écartent de cet encombrant appareillage narratif et s’arrête à ce que l’on attend de lui : délivrer un pur spectacle sportif.
Réalisateur fou de technique, Kosinski pense ces séquences en monoplace comme des précipités d’immersion intégralement conçues pour l’expérience de la salle obscure. À la faveur de micro-caméras équipées dans les véhicules, le spectateur se trouve embarqué dans de longs rides de stimuli visuels et auditifs. Multipliant les angles, construisant ses cadres comme autant de précis de géométrie maniaque qui subliment l’esthétique racée des courbes de la Formule 1, le cinéaste capte comme rarement le sentiment d’allégresse de la vitesse.
Le film s’affirme comme le contrechamp réussi, totalement techniciste, brut et matérialiste, du Ferrari de Michael Mann, autre œuvre traversée d’impitoyables courses de bolide mais sur un versant beaucoup plus abstrait et volontairement chaotique et fragmentaire. À cet égard, le visionnage en IMAX n’est pas recommandé mais bien impératif.
Surtout, la bonne idée de F1 est d’agencer ces courses GP comme de véritables blocs dramaturgiques, toujours à multiples niveaux d’enjeux : Pitt arrivera-t-il à faire alliance avec son jeune coéquipier, et inversement ? La voiture fournie sera-t-elle assez puissante pour concurrencer les autres ? L’équipe technique arrivera-t-elle à changer assez vite les pneus pour gagner la microseconde décisive ? Le montage, brillant, et qu’on imagine herculéen de travail, sert alors de liant entre toutes ces scénographies avec une admirable limpidité.
D’autant que la victoire n’est jamais le but principal de l’écurie, bonne dernière du championnat qui n’aspire qu’à gratter un seul pauvre point pour se maintenir professionnelle. Cet enjeu force Sonny Hayes à miser sur la roublardise en jouant avec les zones grises du règlement, et donne la sensation vivifiante de regarder avant tout un combat (mot répété à de multiples reprises) d’underdog. La séquence au GP de Monza, longue de plus d’une vingtaine de minutes, en constitue l’illustration parfaite et est ce que le récit produit certainement de plus jouissif.

LA SUITE SPIRITUELLE DE TOP GUN MAVERICK
Il est aussi passionnant de voir à quel point F1 fonctionne, peut-être à son corps défendant, en symbiose du précédent métrage de Kosinski, Top Gun Maverick, l’un prolongeant les thématiques de l’autre.
Dans les deux œuvres sont présentées d’anciennes vedettes de leur discipline, arrivées au crépuscule de leur puissance, et à qui l’on somme de passer la main, tantôt aux jeunes cadets de l’Air force, tantôt à une vedette montante de l’écurie APXGP. Voilà donc Sonny Hayes et Pete Maverick tenus à un rôle de mentor qu’ils embrassent presque sans broncher, jusqu’à rappeler dans le dernier sprint final du récit que pour sauver la mise – ou le monde – il faudra encore compter sur eux : soit le passeur redevenu in extremis le sauveur.
Un même tempérament guide aussi les deux personnages, dans la droite lignée du héros classique américain : refus de l’ordre et des institutions (impératifs médiatiques ou consignes de son écurie), capacités hors du commun (le vol ou le pilotage automobile) et individualisme menant mécaniquement à une vie de solitude, qui ne se trouble néanmoins pas de quelques escapades romantiques.
Mais à la différence de Tom Cruise, acteur plus autocentré et freak control (c’est Pitt qui tourne avec Leonardo Di Caprio dans Once Upon a Time… in Hollywood, pas l’inverse), la mélancolie n’est jamais loin chez l’acteur d’Ad Astra. Elle infuse ce regard bleu azur lors de l’ultime course, lorsque tous les concurrents, par l’entremise d’une pirouette scénaristique, lui laissent soudain la pole position et que devant lui s’éclaire l’horizon de la victoire ardemment désirée.
Le film s’autorise alors une pause dans ce visage, un instant de suspension plutôt qu’une folle dernière montée d’adrénaline, lorsque le pilote fait enfin symbiose avec le temps, l’espace, la vitesse et le destin. Dans les yeux de Pitt se lit alors autre chose que l’accomplissement triomphaliste (qu’il refuse d’assumer plus tard, d’ailleurs), mais comme un concentré de la fin d’un monde. La conscience que ce moment de plénitude total du surdoué avec sa matière sera, peut-être, le dernier. Voilà le privilège des grands acteurs : se glisser entre les lignes du script, surélever le personnage, y offrir une transcendance inattendue.
De quoi lustrer d’un dernier éclat la carrosserie d’un bolide formaté mais qui ressuscite une vertu perdue du film hollywoodien à gros budget contemporain : le vertige du spectacle.
Voir la bande-annonce :
Auteur/Autrice
Partager l'article :