Il y a 57 ans, le 27 septembre 1968, 2001 : L’Odyssée de l’espace débarquait dans les salles françaises, révolutionnant la science-fiction et la place de la musique au cinéma.
« Il est vain d’employer quelqu’un qui n’est pas l’égal d’un Mozart, d’un Beethoven ou d’un Strauss pour écrire une musique de film orchestrale. Pour cela, on a un vaste choix dans la musique du passé », déclarait Stanley Kubrick dans un entretien en 1976. Cette phrase illustre parfaitement le rapport singulier du cinéaste culte à la musique : loin de confier ses films à des compositeurs contemporains, il puise dans le répertoire classique et moderne, réutilise des oeuvres existantes et les réinvente en les associant à l’image.
Kubrick ou l'audace des choix classiques
Sorti en 1968, 2001 : L’Odyssée de l’espace est le premier de ses films à faire un usage aussi marquant de la musique classique. Kubrick y forge un véritable langage cinématographique, où le son et l’image s’élèvent ensemble vers une dimension philosophique et sensorielle nouvelle. L’ouverture emblématique du film, portée par le prélude majestueux d‘Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss (1896), en est l’exemple le plus éclatant. Inspirée du texte de Nietzsche, l’œuvre musicale symbolise l’aube, l’éveil et la quête de sagesse. Chez Kubrick, elle devient bien plus qu’un lever de soleil : elle accompagne la naissance de l’humanité et annonce les thèmes centraux du récit, la découverte, la transformation, la transcendance.
Dans cette séquence inaugurale, un fondu noir cède la place à la Lune, puis à la Terre et enfin au Soleil qui s’élève lentement sur un crescendo orchestral. Le cinéma se fait ici symphonie visuelle et sonore. Avant de choisir cette voie, Kubrick avait pourtant commandé une partition originale à Alex North, son compositeur attitré. North travailla plusieurs mois sur le film, composant plus de 40 minutes de musique. Finalement, le réalisateur finit par conserver les musiques classiques utilisées comme pistes temporaires et écarte la composition originale. Un choix audacieux et surprenant, qui rompait avec les habitudes du cinéma hollywoodien.

Entre rejet et admiration
Lors de la sortie du film, ce choix a déconcerté une partie du public et de la critique. À l’avant-première, le 2 avril 1968, au Uptown Theater à Washington, D.C., une partie des spectateurs quitte la salle, déroutée par la lenteur et l’abstraction du récit. Le journal Newsweek y voyait alors un spectacle « ostentatoire et creux », tandis que le New York Times décrivait le film comme « quelque part entre hypnotique et immensément ennuyeux ». En France aussi, plusieurs critiques jugent le film trop hermétique, à sa sortie le 27 septembre 1968. Mais d’autres saluent l’audace visuelle et sonore : les effets spéciaux, l’ampleur musicale et l’expérience sensorielle inédite. Cette réception contrastée montre combien le pari de Kubrick bousculait les attentes d’un cinéma de science-fiction jusque-là plus narratif et démonstratif.
Kubrick le dit lui-même : il voulait « contourner l’entendement et ses constructions verbales pour mieux pénétrer l’inconscient ». La musique, et tout autant les silences qui la soulignent, deviennent un langage parallèle. Dans la scène « l’aube de l’humanité », les cris des primates face au monolithe cèdent soudain la place à un silence solennel, traduisant mieux qu’aucun dialogue la naissance de la conscience. Le spectateur est happé dans ce moment suspendu, partagé entre vertige et fascination.
Ainsi, Strauss n’est pas un simple accompagnement sonore : ses notes grandioses provoquent un émerveillement quasi mystique, renforcé par les contrastes avec le silence. La musique agit ici comme un catalyseur émotionnel et narratif, invitant le spectateur à un voyage qui dépasse l’écran. Cette démarche n’est pas un cas isolé. Kubrick poursuivra ce principe dans Orange mécanique (Beethoven, Rossini), Barry Lyndon (Haendel, Schubert) ou encore Shining (Ligeti, Penderecki). Chaque fois, il inscrit des chefs-d’oeuvre du passé dans un nouvel imaginaire visuel et sensoriel, construisant une véritable signature musicale.

un héritage culturel et populaire
Avec 2001, l’ouverture d’Ainsi parlait Zarathoustra est sortie du cercle restreint des mélomanes pour devenir un motif universel de la culture populaire. Dès les années 1970, la pièce est revisitée : la Portsmouth Sinfonia en propose une version chaotique volontairement amateure, devenue culte, tandis qu’Emir Deodato en livre une adaptation funk-jazz qui connaîtra un immense succès et sera utilisée dans Bienvenue Master Chance ou encore des publicités Coca-Cola.
La culture populaire s’en empare avec enthousiasme. Elvis Presley s’en sert pour ouvrir ses concerts, La Cinq l’utilise pour son JT à la fin des années 1980, et Les Simpsons multiplient les clins d’oeil au film. Plus récemment, Greta Gerwig a ouvert son Barbie par une parodie directe du prologue, remplaçant les singes par des petites filles brisant leurs poupées. Aujourd’hui, ces quelques notes sont devenues un signe universel, associé à la révélation et à l’émerveillement. Kubrick a transformé une oeuvre savante en symbole collectif, immédiatement reconnaissable et réinterprété dans les contextes les plus variés.
Si les grandes sages de sciences-fiction postérieures (de Star Wars à Alien) ont préféré des partitions originales, 2001 a montré que la musique pouvait être plus qu’un simple accompagnement : un langage sensoriel et philosophique. L’héritage se lit encore dans des choix audacieux, comme l’usage de chansons pop dans Seul sur Mars ou les partitions hybrides de Daft Punk pour Tron : Legacy. Plus largement, le film révèle comment le cinéma peut démocratiser la musique. En une séquence, Kubrick a fait d’un prélude symphonique réservé aux connaisseurs un véritable « tube » universel, associé à l’idée de grandeur et de mystère cosmique.
Auteur/Autrice
Partager l'article :
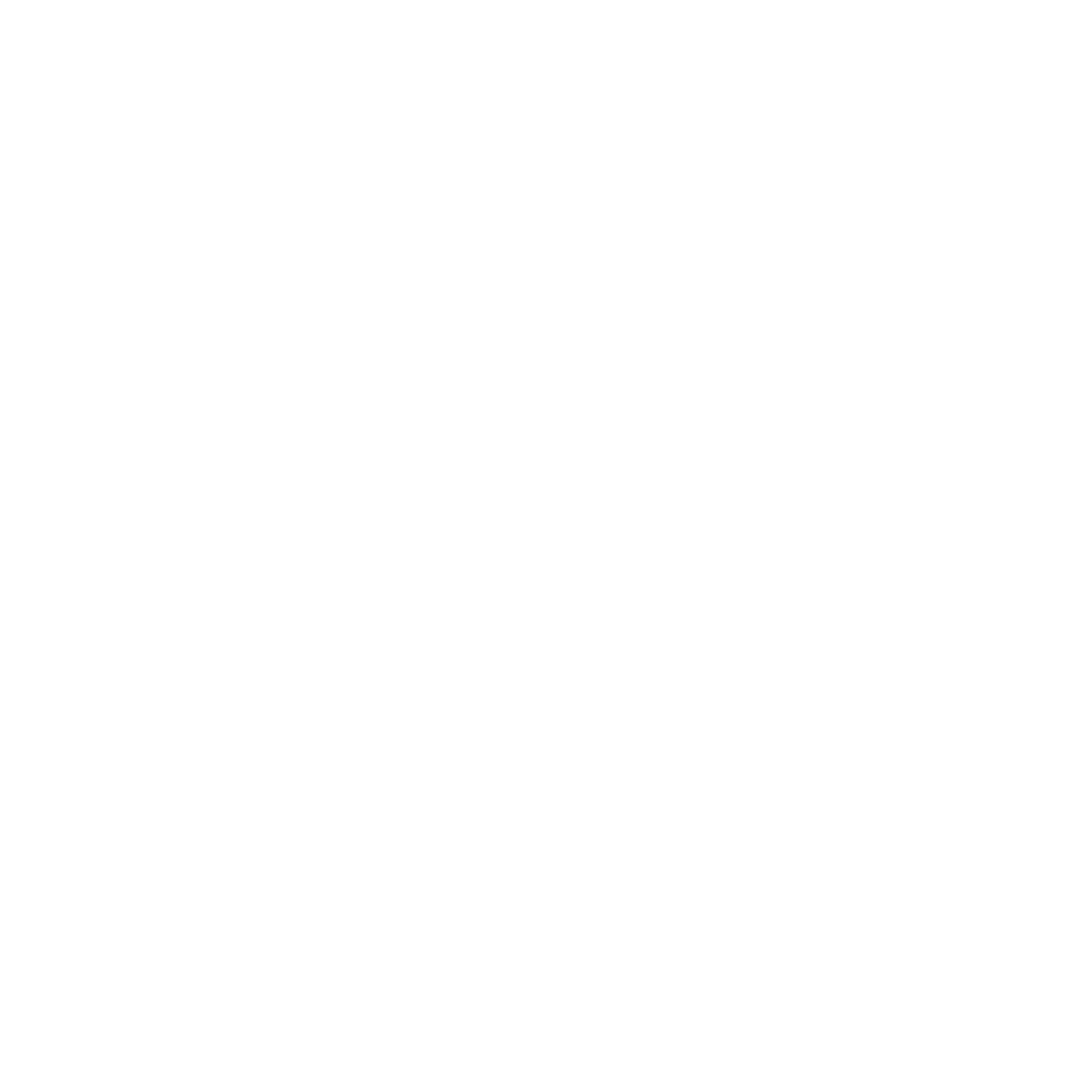

1 Comment
Comments are closed.