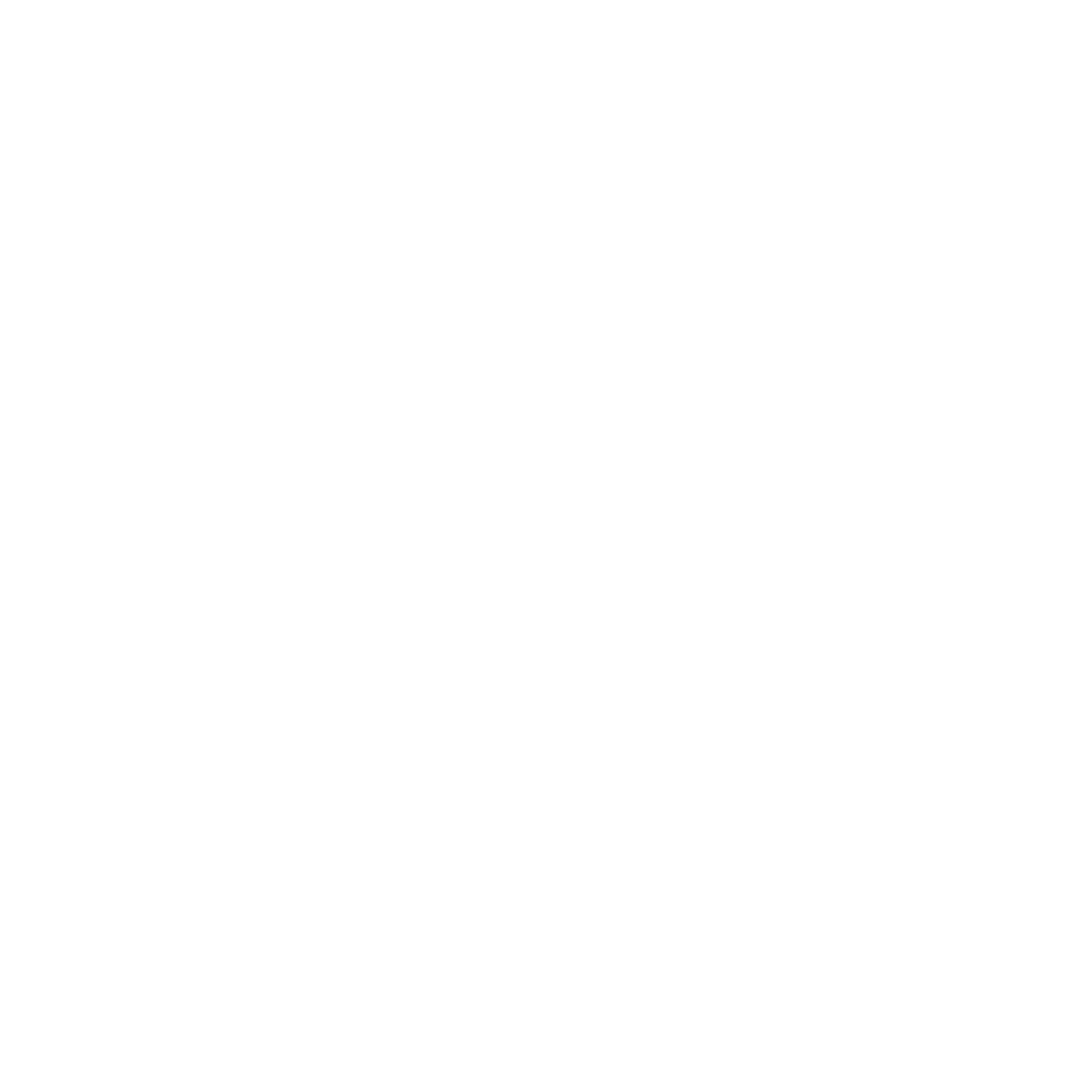Après presque un an d’audition, la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs de la culture vient de publier son rapport.
Une longue enquête
Créée en mai 2024, puis interrompue à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, la commission avait été relancée en octobre dernier. Présidée par la députée d’Europe Écologie Les Verts (EELV) Sandrine Rousseau, elle avait pour but de faire un état des lieux des violences commises dans le monde de la culture. L’objectif étant « d’identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences, et établir les responsabilités de chaque acteur en la matière » ainsi que « d’évaluer la situation des mineurs évoluant dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité ». Ce mercredi 9 avril, la commission publiait un rapport de plus de 600 pages délivrant ses conclusions sur les facteurs de risque qui ont été identifiés, ainsi que plusieurs recommandations. Pour ce faire, 85 auditions et tables rondes ont eu lieu, représentant ainsi plus de 118 heures d’échanges avec 350 professionnels de différents milieux culturels. De longs entretiens qui sont pour certains disponible en entier sur la chaîne YouTube LCP Assemblée nationale.
Que ce soit dans la réalisation, la production, le maquillage, mais aussi la télévision ou bien le journalisme et la critique, tous les secteurs de la culture et/ou de l’audiovisuel ont été auditionnés. Judith Godrèche a notamment témoigné sur les violences qu’elle a subies au cours de sa carrière, et notamment lors de ses tournages avec Benoît Jacquot et Jacques Doillon. En début d’année 2025, Florence Porcel, journaliste et autrice, était intervenue lors d’une des séances pour revenir sur sa plainte pour viol contre Patrick Poivre d’Arvor. Cela en même temps que Amandine Lach, critique cinéma et ambassadrice de MeTooMedia, qui s’était livrée sur les violences sexuelles et psychologiques qu’elle avait subies de la part d’une personnalité bien connue du milieu. Elle a aussi présenté l’état plus qu’inquiétant du secteur de la critique sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Certaines personnalités bien connues sont aussi passées dans cette commission comme Gilles Lellouche, Pierre Niney, ou encore Jean-Paul Rouve, mais en demandant l’absence de caméra, n’offrant qu’un rapport de leur passage.
Les différentes conclusions
Cette enquête de plusieurs mois a permis de relever différents facteurs de risque. Le premier étant la précarité des professionnels du milieu. Beaucoup travaillent avec la peur de perdre leur emploi, conduisant ainsi certains et certaines à accepter et à tolérer des abus. Les auditionnés dénoncent aussi le rapport de force et les relations de pouvoir dans ces milieux. « Nous sommes un tout petit milieu, où tout le monde se connaît : perdre du travail, ça va très vite » explique Séphora Haymann, metteuse en scène et autrice. Stéphane Gaillard, directeur de casting à l’origine de MeToo garçons s’exprime aussi sur ce sujet : « La loi du silence est là : si tu parles, tu payes, tu es éjecté ».
Un rapport de force accompagné par une forme de culte du créateur et du talent. Un système qui renforce les emprises, et pardonne plus facilement les abus lorsqu’ils sont commis par certaines personnes, et souvent des hommes. « Le cinéma est un système où les dynamiques de pouvoir sont profondément déséquilibrées » raconte Mme Anne Ricaud, membre du Syndicat des scénaristes. « Les violences trouvent en partie leur origine dans la concentration des pouvoirs. L’œuvre audiovisuelle est collective, mais cet aspect a été occulté au profit de la vision d’une seule personne : le réalisateur. Ce culte de l’auteur, amplifié par la Nouvelle Vague, a concentré un pouvoir démesuré entre les mains de quelques-uns, créant un terrain favorable aux abus ». Le tout est accentué par une promiscuité et une confusion permanente entre vie professionnelle et vie personnelle.
Pour ce qui est de l’emploi de mineur, nombre d’atteintes au règlement ont été relevées. « Sur la quasi-totalité des tournages avec des enfants, on m’a demandé de tricher sur les horaires, car on les dépasse systématiquement », témoigne une scripte qui a préféré rester anonyme. « Les équipes de production considèrent souvent qu’un jeune de 16 ans n’est plus vraiment un mineur et qu’il n’a pas besoin de chaperon. Or, c’est souvent entre 16 et 18 ans que les atteintes sexuelles ont lieu » explique Mme Nathalie Tissier, membre de l’Association des maquilleuses et maquilleurs du cinéma.
Quelques recommandations
La commission d’enquête émet en tout 86 recommandations parmi lesquelles étendre le cadre juridique actuel aux mineurs âgés de 16 à 18 ans, prohiber la représentation sexualisée des mineurs à l’écran, ou encore mieux protéger les enfants de moins de 7 ans. De meilleurs contrôles auprès du CNC (Centre Nationale du cinéma et de l’image animée) sont aussi mis en avant, avec des certifications et des rapports de fin de tournage faisant état de son déroulement. Mais aussi de réel contrôle de l’inspection du travail en lien avec le CNC et le CNM (Centre Nationale de la Musique). Des formations obligatoires pour sensibiliser aux questions des violences sexistes et sexuelles ont été évoquées.
Pour les acteurs et actrices, la commission propose aussi des systèmes pour « encadrer les scènes d’intimité des productions cinématographiques et audiovisuelles, en rendant obligatoires des clauses détaillées au contrat, en proposant obligatoirement aux acteurs la médiation d’un coordinateur d’intimité et en donnant un droit de regard aux comédiens sur le montage final, sous l’égide du CNC ». Il y a aussi pour objectif de limiter les phénomènes d’omerta et de confronter les employeurs du secteur culturel lors de ces affaires. Le tout étant accompagné d’un contrôle de la parité lors de la distribution d’aides publiques pour les secteurs culturels, y compris pour les associations.
Auteur/Autrice
Partager l'article :